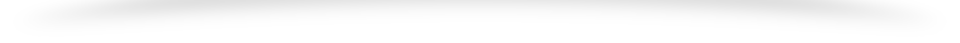La transition vers les voitures électriques s’impose aujourd’hui comme un levier majeur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Pourtant, la comparaison entre véhicules électriques et modèles thermiques reste parfois source de débats et d’incompréhensions. Au-delà de l’absence d’émissions directes à l’usage, les voitures électriques intègrent dans leur bilan carbone la fabrication de leurs batteries et la provenance de l’électricité qui les alimente. En 2025, face à l’évolution rapide des technologies et des mix énergétiques nationaux, il devient essentiel de disséquer précisément les postes d’émissions liés à chaque étape du cycle de vie, afin d’évaluer l’impact réel des véhicules électriques comparés aux moteurs thermiques classiques issus des marques telles que Renault, Peugeot, Citroën, Nissan, Tesla, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz et Fiat. Ainsi, l’analyse détaillée des émissions pendant la production, l’utilisation et la fin de vie offre une vision complète et nuancée de leur empreinte écologique, indispensable pour orienter les choix politiques, industriels et individuels.
Les émissions de CO2 lors de la fabrication : le poids environnemental des batteries électriques
La fabrication d’un véhicule, qu’il soit électrique ou thermique, génère des émissions de CO2 significatives. Cependant, les voitures électriques affichent une empreinte carbone lors de leur fabrication environ 1,5 fois supérieure à celle des voitures thermiques, principalement à cause de leurs batteries. Ces batteries lithium-ion nécessitent l’extraction de métaux rares tels que le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse, dont l’extraction est non seulement énergivore mais aussi socialement complexe. Par exemple, la République Démocratique du Congo assure une grande partie du cobalt mondial, avec des conditions d’exploitation souvent critiquées pour leur impact humain et environnemental.
Les constructeurs comme Tesla et Volkswagen œuvrent à réduire la teneur en cobalt dans leurs batteries et à privilégier des sources responsables, tout en explorant les technologies alternatives telles que les batteries lithium-fer-phosphate qui limitent l’usage de métaux rares. Ces innovations tendent à diminuer l’impact environnemental mais ne le suppriment pas. De plus, la production des batteries mobilise des quantités importantes d’énergie, souvent issue de sources fossiles, ce qui amplifie l’empreinte carbone initiale.
À titre d’exemple concret, une voiture électrique comparable à une Renault Zoe ou une Nissan Leaf peut générer entre 20 et 30 % d’émissions supplémentaires à la fabrication par rapport à un modèle thermique équivalent, par exemple une Peugeot 308 ou une Fiat Tipo. Toutefois, cette différence est appelée à se réduire grâce aux gigafactories utilisant des énergies renouvelables, comme celle de Northvolt en Suède, qui alimente ses lignes de production en énergie verte, diminuant ainsi l’empreinte carbone de chaque batterie fabriquée.
La complexité des matières premières et leurs conséquences sur le bilan carbone
Le lithium extraction, souvent issu de zones arides comme le désert d’Atacama au Chili, requiert de vastes quantités d’eau, avec près de 1,9 million de litres nécessaires pour extraire une tonne de lithium. Cette consommation pose des défis environnementaux et sociaux majeurs dans des régions déjà fragiles. Le nickel, quant à lui, provient essentiellement de zones tropicales telles que l’Indonésie, où sa production est associée à une destruction accélérée des forêts et à la pollution des cours d’eau, provoquant la dégradation d’écosystèmes entiers.
Face à ces questions de durabilité, les filières s’orientent vers des solutions de recyclage. En Europe, le taux de recyclage des batteries atteint environ 90 %, avec des acteurs comme Umicore qui développent des procédés hydrométallurgiques performants permettant la récupération des métaux essentiels pour la fabrication de nouvelles batteries. Cela permet d’alléger l’impact dû à l’extraction, réduisant ainsi les émissions liées à la production de véhicules électriques sur le long terme.
Les émissions pendant l’utilisation des voitures électriques et thermiques : efficacité énergétique et mix énergétique
Le principal avantage immédiat des véhicules électriques réside leur phase d’utilisation, où ils n’émettent aucun gaz à effet de serre en direct, contrairement aux voitures thermiques équipées de moteurs à essence ou diesel qui brûlent du carburant fossile. Cependant, il faut considérer que les voitures électriques consomment de l’électricité, dont l’empreinte carbone dépendra de la composition énergétique du réseau local.
Sur le plan de l’efficacité, le moteur électrique affiche un rendement énergétique remarquablement élevé, entre 80 % et 90 %. Cette performance dépasse très largement les 30 à 40 % atteints par les moteurs thermiques, même dans des conditions optimales. À titre d’exemple, un moteur à essence de Peugeot ou Mercedes-Benz perd jusqu’à 70 % de l’énergie du carburant sous forme de chaleur, alors que la voiture électrique, qu’il s’agisse d’un Tesla ou d’une BMW, utilise presque toute l’énergie fournie pour le déplacement.
Comparaison de l’empreinte carbone globale sur le cycle de vie complet
Le véritable enjeu pour comprendre l’impact environnemental des véhicules électriques et thermiques réside dans l’évaluation des émissions cumulées sur toute la durée d’utilisation, depuis la production jusqu’au recyclage. Selon les études les plus récentes du Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) et l’ADEME, les voitures électriques deviennent plus avantageuses en termes de CO2 dès que leur kilométrage cumulé dépasse en moyenne 30 000 à 50 000 km.
Par exemple, un modèle électrique tel qu’une Tesla Model 3 affiche initialement une empreinte carbone plus élevée due à la batterie, comparée à une BMW Série 3 thermique similaire. Pourtant, dès 37 000 km d’usage, la balance penche en faveur du véhicule électrique, ce qui augmente avec la durée – la différence pouvant atteindre plus de 50 % de réduction totale des émissions à la fin du cycle de vie.
En revanche, pour des véhicules parcourant peu de kilomètres annuellement, l’écart est moins marqué. Cela dépend également du mix énergétique local comme vu précédemment. En Suède, grâce à un bouquet énergétique très vert, cet équilibre est atteint beaucoup plus rapidement qu’en Pologne où l’électricité est majoritairement carbonée.
L’importance du recyclage et de la seconde vie pour réduire l’empreinte carbone des voitures électriques
La gestion en fin de vie est un volet clé pour minimiser les émissions totales des voitures électriques, notamment en ce qui concerne leurs batteries au lithium-ion. La durée de vie moyenne d’une batterie est estimée entre 8 et 12 ans, après quoi elle conserve entre 70 % et 80 % de sa capacité initiale, lui permettant d’être réutilisée dans des systèmes de stockage stationnaires d’énergie renouvelable, retardant ainsi le besoin de fabrication d’une nouvelle batterie.
Des programmes pilotes, comme celui utilisant d’anciennes batteries de Nissan Leaf pour alimenter la Johan Cruyff Arena à Amsterdam, montrent comment la réutilisation contribue à limiter l’extraction de matériaux et à réduire l’empreinte carbone globale.
Enfin, l’évolution vers des batteries à base de lithium-fer-phosphate (LiFePO4), moins polluantes et plus faciles à recycler, combinée à une réduction de la dépendance au cobalt et au nickel, annonce une amélioration notable de l’impact environnemental en fin de cycle pour les véhicules électriques.